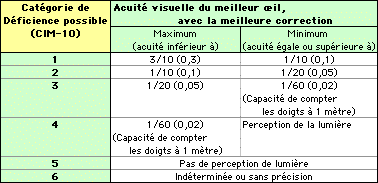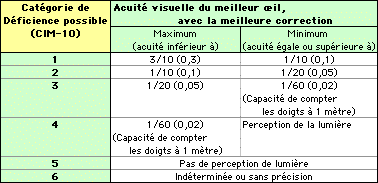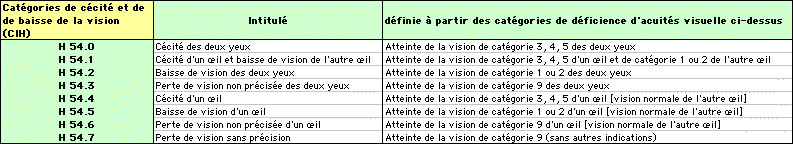CÉCITÉ ET MALVOYANCE
La Classification Internationale des Handicaps codifie de manière précises les principales formes d'atteintes visuelles, que celles-ci soient provoquées par une déficience de l'acuité visuelle de l'un ou des deux yeux (tableau II), une déficience du champ visuel, une atteinte des structures annexes de la fonction visuelle ou par une lésion cérébrale générant des troubles neuro-visuels.
Si l'on ne retient comme critères descriptifs que l'acuité et le champ visuel il est possible de classer en cinq catégories les déficiences visuelles (tableau I) ainsi qu'elles sont présentées dans la Classification statistiques Internationale des Maladies et des problèmes de santé connexes dixième révision (CIM-10).
De ces cinq catégories, il est enfin possible de différencier les deux notions classiques :
- La cécité, qui correspond à une acuité visuelle du meilleur oeil avec correction, au maximum inférieur à 1/20 (0,05), ou à un champ visuel inférieur à 10 ° quelle que soit l'acuité visuelle (catégories de déficience visuelle 3, 4 et 5 de la CIM-10),
- L'amblyopie, (ou malvoyance), correspond à une acuité visuelle inférieure à 3/10 (0,3), mais égale ou supérieure à 1/20 (0,05) du meilleur oeil avec correction (catégories de déficience visuelle 1 et 2 de la CIM-10).
Par ailleurs, l'OMS (Bangkok 1992) défini le malvoyant comme étant une personne présentant une déficience visuelle même après traitement et/ou meilleure correction optique dont l'acuité visuelle est comprise entre 6/8 (0,3) et la perception de la lumière, ou dont le champ visuel est inférieur à 10 autour du point de fixation, mais qui utilise -ou est potentiellement capable d'utiliser- sa vue pour planifier et/ou exécuter une tâche.
En France, on parle de :
- Cécité complète(2) lorsqu'il y a une absence totale de perception de lumière, (ce qui correspond à la catégorie 5 de la CIM-10),
- Quasi-cécité(2) quand l'acuité visuelle est égale ou inférieure à 1/20 d'un oeil, celle de l'autre étant inférieure à 1/20, avec déficience des champs visuels périphériques lorsque le champ visuel n'excède pas 20° dans le secteur le plus étendu,
- cécité professionnelle(2), quand l'acuité visuelle du meilleur oeil après correction est inférieure ou égale à 1/20, ou dont le champ visuel est inférieur à 20° dans son secteur le plus étendu, (ce qui correspond à la catégorie 3 de la CIM-10).
- La mention Cécité(1) sera apposé sur la carte d'invalidité des personnes dont la vision est nulle ou inférieure à 1/20 de la normale.
- La mention Canne blanche(1) sera apposé sur la carte d'invalidité des personnes dont la vision est au plus égale à 1/10 de la normale.
Sources :
(1) Article 174 du Code de l'aide sociale (loi du 30 juin 1975),
(2) Guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Décrets n° 93-1216 et 93-1217 du 4 novembre 1993 et le décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
Classification Internationale des Handicaps : Déficiences, Incapacités, désavantages. OMS, CTNERHI/INSERM 1998
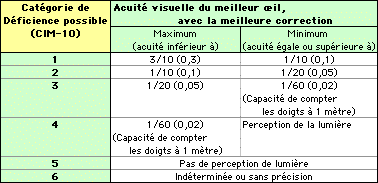
Tableau I :
Classification des atteintes de la vision suivant leur gravité,
définie dans la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santés connexes, Dixième Révision, OMS 1993
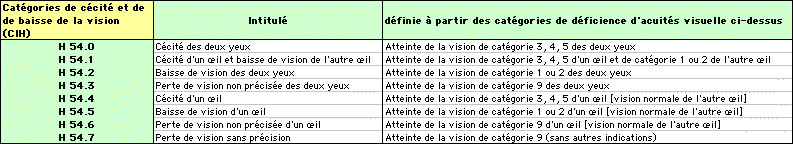 Tableau II :
Tableau II :
Catégories de cécité et de baisse de la vision,
définie dans la Classification Internationale des Handicaps
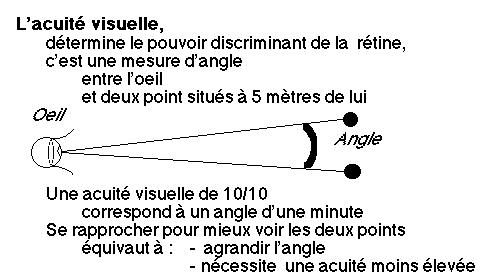
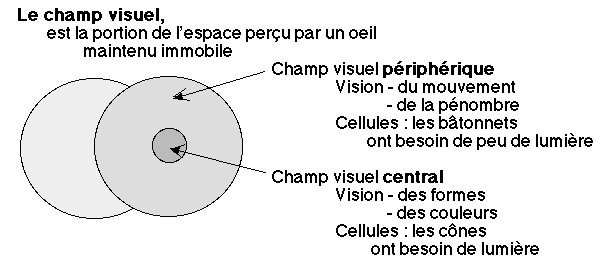
-
Le terme cécité vient du mot latin «caecus», qui
veut dire aveugle. La cécité est donc «l´état
d´une personne aveugle». L´aveugle, au sens strict, est celui
qui est privé de ses yeux (ab oculis), celui qui est privé
de la vue. Or, à ce sens strict de privation totale, on fait correspondre
une privation partielle. Dans le sens réglementaire français,
la cécité commence dès que l´acuité est
inférieure à 1/20. Il peut donc aussi bien s´agir de
sujets aveugles, au sens strict (sujets n´ayant aucune perception visuelle),
que de sujets ne pouvant être considérés ni comme des
aveugles, car ils ont une acuité chiffrable et un potentiel visuel,
ni comme des malvoyants, car cette acuité est inférieure à
1/20.
- Il est intéressant de remarquer que cette ambiguïté fondamentale,
contenue dans le terme de cécité, existe tant au niveau réglementaire
qu´au niveau social. Toute personne, si elle n´est pas particulièrement
avertie en matière de déficience visuelle, utilise les termes
«cécité» et «aveugle» au maximum de leur
ambiguïté. Pour le grand public, les notions de malvoyance ou
d´amblyopie sont des notions peu connues. Pour un grand nombre de personnes
on est voyant ou l´on est aveugle, et si l´on est aveugle cela veut
dire que l´on est un handicapé de la vue, sans que la nature et
la gravité de la déficience et du handicap soient clairement
définies. Combien de sujets malvoyants sont considérés
par leur entourage comme des aveugles ?
- La meilleure connaissance de la vision en terme ophtalmologique, neurophysiologique
et fonctionnel a amené les professionnels à préciser
qu´ils entendent par cécité, l´absence de possibilités
visuelles au sens strict : ne pas, ou ne plus, avoir de potentiel visuel.
Atteinte de la vision centrale
- Le premier grand type de malvoyance est le mieux connu. Il s´agit des cas où l´atteinte visuelle concerne la partie centrale de la rétine. Les cellules regroupées à cet endroit de la rétine permettent la vision des formes et des couleurs, mais surtout ont un très grand pouvoir discriminant. Ce sont elles qui rendent possible la vision des détails. Avoir une atteinte de cette partie de la rétine suppose donc une réduction importante de l´acuité visuelle. Les sujets dans ce cas décrivent une tache au niveau du point de fixation visuel, plus ou moins étendue en fonction de la taille de l´atteinte centrale de la rétine. Cette tache n´est évidemment pas contournable. Bouger l´oeil et changer le point de fixation correspond à déplacer la tache vers le nouveau point fixé. L´oeil bouge, mais la gêne visuelle suit.
- Pour ces sujets le handicap va concerner la vision de près et l´ensemble
des activités nécessitant un contrôle visuel précis.
Au premier rang d´entre-elles la lecture et le contrôle visuel
de l´écriture vont être rendus difficiles ou impossibles.
Ils vont conserver une bonne perception de l´espace, des grandes formes
et du mouvement. De ce fait, hormis dans les zones de fort encombrement, ils
pourront continuer à circuler et se déplacer. En revanche il
leur sera difficile ou impossible de lire de près des caractères
de taille normale (dactylographique, d´imprimerie ou de journaux), ou
de plus loin des caractères un peu plus grands (le nom d´une rue,
le numéro de quai d´un train...)
Illustration de ce type d'atteinte, réalisée par l'Association Rétina Suisse
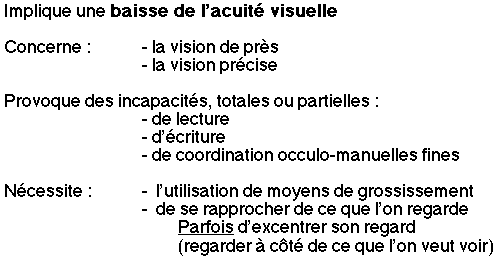
Atteinte de la vision périphérique
- Pour rester très schématique, on peut décrire la deuxième catégorie de malvoyance comme étant à l´opposé de la précédente. Dans ce cas, ce n´est plus la vision centrale et l´acuité visuelle qui sont atteintes, mais le champ périphérique. Les sujets n´ont plus de perception visuelle possible ou de qualité suffisante, autour du point de fixation. Au contraire leur champ visuel se rétrécit jusqu´à devenir tubulaire. Ils conservent une acuité correcte, la zone maculaire de la rétine n´étant pas atteinte, mais ils ne voient que ce qu´ils fixent et plus rien autour, ou presque, comme lorsque l´on regarde dans un tube ou un canon de fusil. Il leur est possible de regarder à côté du précédent point de fixation, s´ils déplacent leur regard, mais alors ils ne perçoivent plus ce qui était précédemment fixé.
- Le handicap conséquent de ce type d´atteinte périphérique, à la suite par exemple de certaines formes de rétinite pigmentaire, est particulièrement invalidant mais aussi difficilement compréhensible d´emblée par l´entourage. Les sujets conservent des capacités de lecture, mais il leur faut, pour lire efficacement, que la taille des caractères soit suffisamment réduite pour ne pas dépasser la largeur de leur champ visuel. Ainsi, il leur est parfois plus aisé de lire des caractères de journaux que les manchettes de ces mêmes journaux, une notice qu´un placard publicitaire, un dictionnaire qu´un plan de ville. Pour eux, à l´opposé de l´idée communément admise, grossir un texte revient à accroître d´autant leurs difficultés.
- Par ailleurs ces patients ont besoin d´une quantité de lumière plus importante que la moyenne pour voir efficacement et, en deçà d´un seuil, manquent d´informations visuelles pertinentes. Dans l´obscurité et en vision nocturne le handicap peut être plus important, ou dans certains cas, total.
- Enfin ces sujets sont fortement gênés pour se déplacer. Leur champ visuel réduit à quelques degrés, leur permet de pointer précisément des éléments de l´espace environnant, mais de manière isolée, morcelée, comme un puzzle dont chaque pièce n´est perçue qu´isolément sans parvenir à une globalité et une continuité de l´image. Alors qu´à l´arrêt ils peuvent percevoir et lire des informations de petite taille, en dynamique (pour se déplacer ou suivre visuellement un ou plusieurs déplacements d´objets, de voitures, de passants...), l´étroitesse de leur champ de vision limite leur efficience et partant leur autonomie.
Illustration de ce type d'atteinte, réalisée par l'Association Rétina Suisse
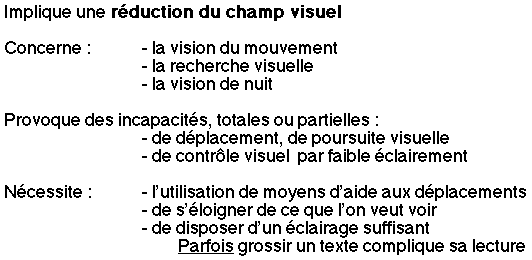
La vision floue
- La troisième forme de déficience visuelle est celle d´une vision globalement floue. La vision des sujets dans ce cas ressemble à celle que l´on peut avoir à travers un verre dépoli. La lumière passe toujours mais dans un milieu qui, par son opacité, la diffuse. La source lumineuse, au lieu de se réfléchir précisément sur la rétine, se diffuse et ses contours s´atténuent.
- La perception de l´environnement par ces sujets est une perception de forme, de masse, d´ombres et de lumières aux limites d´autant plus mal définies que la déficience est importante. Les contrastes, les distances et les reliefs deviennent difficiles à apprécier de près, et surtout de loin. L´environnement se fond dans une imprécision faite autant d´atténuations des formes, des couleurs et des aspects saillants, que de confusions. Il perd son attrait, son caractère et son intérêt intellectuel ou esthétique. Plus rien ne ressort, n´attire l´oeil, que des formes et des lumières plus ou moins vives, dans les cas les plus graves. La motivation à regarder n´est plus qu´utilitaire : pour s´orienter, pour analyser des formes et tenter d´y reconnaître un objet, une direction ou un danger. Le plaisir de voir est lui fort limité quand ce n´est pas inexistant. Les sujets qui avaient auparavant une vision normale, soulignent souvent cette impression de percevoir un espace neutre, froid et approximatif, d´où peut surgir un danger, mais qui ne procure pas (plus) de plaisir.
- Les lettres, les petits détails ne sont plus ou mal perçus, et les grandes formes, estompées ou déformées selon l´éclairage et les reflets. En effet, la diffusion de la lumière dans l´oeil et sur la rétine la rend rapidement gênante. Pour ces patients, une forte luminosité est «aveuglante» alors que pour un voyant elle est supportée voire adaptée. On dit qu´ils sont photophobes, ce qui signifie que leur tolérance à la lumière est inférieure à la normale. Le soleil de face, des phares de voiture, le reflet d´une vitrine, les privent momentanément de vision et provoquent des réactions d´évitement et de malaise physique. Réactions que l'on a tous vécues lors d´éblouissements violents.

- Les capacités de réaction et d'adaptation du cerveau humain à un traumatisme ou à une lésion, comme son mode de traitement des informations sensorielles, sont fort complexes et loin d'être totalement maîtrisés par nos connaissances présentes. De plus, dans un assez grand nombre de cas, l'atteinte cérébrale ne provoque pas seulement des troubles de la vision, mais aussi des perturbations neuropsychologiques plus larges ; troubles de l'attention, de la mémoire, du comportement.
- Il est possible de recenser de manière simple et donc nécessairement réductrice, les principaux types de troubles neurovisuels que ces atteintes peuvent provoquer :
- la cécité corticale (ou cécité occipitale), conduit les sujets à se comporter comme des aveugles, en l'absence de lésion de l'oeil ou des voies optiques. Généralement, cet état est transitoirement observé juste après le traumatisme, et il est suivi d'une récupération, variable selon les cas, de l'utilisation consciente du potentiel visuel.
- l'agnosie visuelle est un «trouble de la reconnaissance des éléments du monde extérieur en l'absence de toute perturbation sensorielle élémentaire». Le sujet agnosique peut trouver et utiliser un objet de manière spontanée, mais ne peut pas sur ordre le reconnaître à partir de la simple information visuelle. Incapable de trouver visuellement une clé qu'on lui dit être posée sur la table, il peut l'identifier après l'avoir touché et l'utiliser pour ouvrir une porte. Il a besoin de se servir d'une autre modalité sensorielle pour traiter des informations vues, l'utilisation consciente du canal visuel étant perturbée.
- Les négligences visuo-spatiales sont définies comme «l'impossibilité de réagir, s'orienter, rendre compte de stimuli présentés dans l'hémiespace controlatéral à la lésion hémisphérique». Le traitement et la recherche ordonnée des informations visuelles n'est plus possible du côté opposé à celui de la lésion. On observe que dans la plupart des cas, il s'agit de conséquences de lésions hémisphériques droites. Pour ces patients, ce qui se trouve à leur gauche n'existe plus ou n'est plus pris en compte. Ils ne voient ou ne font attention, par exemple, qu'à la partie droite d'une publicité placée devant eux, ne mangent que ce qui est dans la moitié droite de leur assiette, ont tendance à ne lire que la partie droite d'un texte et ont, par conséquent, des difficultés de retour à la ligne. Pour eux, une rééducation est nécessaire, fondée sur deux principes. Les amener à prendre conscience de cette hémi-négligence généralement ignorée et d'autre part les habituer à suppléer consciemment à leur trouble, par exemple grâce à une verbalisation répétée de la consigne : «Regardez à gauche !» (autant de fois qu'il faut au début de la rééducation, de façon à amener le sujet à y parvenir sans renforcement).
- Les autres troubles neurovisuels regroupent un ensemble de pathologies fort diverses pour lesquelles l'acte de regarder est perturbé et/ou le traitement spatial de l'information perçue ou du mouvement est inéficace. Le regard est fixe, sa commande volontaire défectueuse ou le champ d'attention visuelle est réduit de manière concentrique ( sans que la rétine périphérique soit lésée) et ne permet la perception que d'un objet unique par fixation, quelle que soit la taille de l'objet fixé. (Il s'agit du syndrome de BALINT ou de syndromes proches).
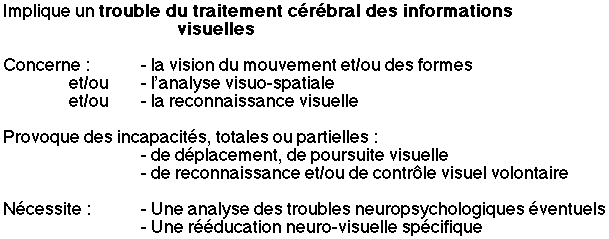
1) Cécité corticale
2) Agnosies des objets
- Agnosie de la forme
- Agnosie intégrative
- Agnosie de transformation
- Agnosie associative
- Agnosie asémantique
- Aphasie optique
Cas particuliers
- Alexie sans agraphie
- Alexie globale
- Alexie verbale
- Alexie littérale
- Prosopagnosie
3) Agnosies spatiales
Syndrome de Balint
1) Rétrécissement concentrique du champ de l'attention
- Simultagnosies (perception simultanée de plusieurs objets ou attributs d'objets)
- Troubles oculomoteurs (exploration spontanée, poursuite, anticipation d'un mouvement)
- Troubles gestuels (extinction si saisie hors du point de fixation)
- Troubles cognitifs (dénombrement, lecture, analyse d'images complexes)
2) Ataxie optique de la main
- Difficulté à guider le geste par la vision dans l'espace extra-
corporel
- Prise parabolique
- Corrections après coup sur informations tactiles
3) Paralysie psychique du regard
- Fixité, errance du regard
- Déplacement volontaire perturbé, saisie fovéales accidentelle
- Abolition du clignement à la menace
Agnosie spatiale unilatérale
1) Incapacité de décrir verbalement, de répondre et de s'orienter sur la base des informations controlatérales à la lésion
- Désorientation (ne pas retrouver les repères gauches)
- Trouble de lecture et d'écriture (mauvais retours à la ligne)
- Trouble de représentation
2) Le patient n'a pas consience de son trouble
- Négligence négligée (pas de compensation spontanée)
- Levée de la négligence non pas progressive mais activité par
activité
3) Négligence qui inclue fréquemment l'espace corporel
- Risque de chocs du côté négligé et de chutes
- Association fréquente à une hémiplégie
4) Dyspraxie visuo-spatiale
Sources :
GRIFFON, P. Déficiences visuelles. Édition du CTNERHI Paris 1995 (avec l'autorisation de l'éditeur)
GRIFFON, P. Troubles neuropsychologiques de la vision. Diplôme d'Université : "Approche neuropsychologique et clinique du Handicap", Université Denis Diderot
Paris VII, Paris 2002
Date de création : 143/02, (dernière mise à jour le 22/01/11)